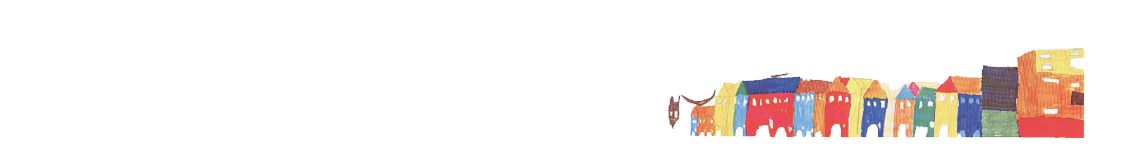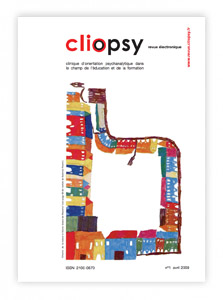Éditorial
Ce numéro 34 de la revue Cliopsy est largement consacré au dossier que nous annoncions l’an dernier à la fin du numéro 32 avec ce titre : Analyse clinique des pratiques professionnelles : quels dispositifs, quels repères théoriques et quelles perspectives aujourd’hui ?
L’appel à contributions publié alors proposait de clarifier les caractéristiques d’une position théorico-clinique d’orientation psychanalytique dans le foisonnement des dispositifs qui figurent sous l’appellation d’analyse des pratiques et, pour cela, envisageait plusieurs questionnements. Par exemple :
– Qu’est-ce qui permet de qualifier un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles de « clinique » ?
– Sur quelles références théoriques repose ce type de dispositif ?
– Comment les animateurs et animatrices mettent-ils·ou mettent-elles en œuvre un tel dispositif ?
– Quels sont les parcours de formation qui conduisent un·e clinicien·e à devenir intervenant·e en analyse des pratiques professionnelles ?
Dans l’introduction à ce dossier rédigée par Claudine Blanchard-Laville, Narjès Guetat Calabrese et Laure Lafarge, on lira comment les auteur·es des contributions retenues ont pu s’emparer de ces questions. Nous pouvons dès maintenant retenir que c’est à partir de leur pratique qu’ils et elles interrogent ce que les dispositifs mis en œuvre peuvent apporter aux métiers du lien. On notera aussi que les auteur·es mettent l’accent sur la difficulté de préserver ces dispositifs face aux contraintes qui pèsent actuellement sur les institutions.
Dans le texte intitulé Faire face au Réel à l’hôpital avec Balint : des groupes d’analyse clinique des pratiques, Laurence Gavarini et Véronique Kannengiesser rapportent leur expérience d’animation de groupes d’analyse des pratiques inspirés par les groupes Balint et menés dans le cadre d’un programme de formation d’un Institut de Formation des Cadres de Santé. Elles montrent comment, dans un contexte institutionnel hospitalier différent de la consultation de médecine générale et actuellement marqué par une gestion néolibérale qui modifie radicalement à la fois la profession d’infirmière et le rôle des cadres de santé, elles ont pu renouer avec l’intention de Balint de se centrer sur la relation de soin. Elles portent plus particulièrement leur regard sur ce moment de la formation où les personnes sont au carrefour entre les soins personnels professionnels et la gestion d’équipe, leur projection en tant que futur cadre supérieur pouvant entrer en conflit avec un désir encore très vivant de prodiguer des soins.
Avec l’article intitulé Faire dispositif : réinscrire la subjectivité en contexte contraint ‒ Une approche clinique de l’analyse des pratiques professionnelles, Saïda El Allouchi propose de considérer l’analyse des pratiques professionnelles (APP) comme un dispositif clinique permettant de réinscrire la subjectivité des professionnels dans des institutions marquées par des logiques gestionnaires. À partir de son expérience en tant que psychologue clinicienne intervenante en APP, elle avance une réflexion selon quatre axes : la demande initiale vue comme symptôme collectif, l’importance d’un cadre sécurisant, la traversée des résistances du groupe et l’évaluation clinique des effets. Elle montre alors comment l’APP dépasse une simple régulation pour devenir un espace de symbolisation, de parole partagée et de transformation des pratiques, le rôle du clinicien étant d’instaurer un cadre contenant, favorisant l’élaboration psychique et la réappropriation individuelle et collective du travail.
Puis, dans le texte intitulé L’analyse clinique des pratiques professionnelles au service de la fonction de liaison – Faire face aux « attaques aux liens » dans des institutions socio-éducatives, Claudine Blanchard-Laville présente un travail d’analyse clinique des pratiques professionnelles mené pendant plusieurs années auprès d’une équipe d’éducateurs et d’éducatrices dans une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS). Elle montre les effets du travail d’élaboration psychique effectué dans cet espace d’analyse des pratiques professionnelles sur les membres de l’équipe et sur l’équipe elle-même. Ce qui l’amène à proposer l’hypothèse que ce type de dispositif est à même de transmettre aux professionnels d’une équipe éducative une capacité à exercer une fonction de liaison pour faire face à ce qu’elle nomme des « attaques aux liens » ‒ en référence au psychanalyste Wilfred R Bion ‒ très prégnantes dans ce type d’institution.
C’est à partir de sa propre expérience de supervision que Chrystèle Grasland- Ferey, dans sa contribution intitulée Les effets de ma participation à un groupe de supervision sur ma posture d’animatrice, tente de mettre en lumière les effets de la supervision groupale. Après une présentation succincte de son parcours professionnel et de formation, elle évoque une séance d’analyse des pratiques professionnelles qu’elle a animée auprès d’étudiant·es en formation de moniteur-éducateur·et·monitrice-éducatrice dans un Centre de formation en travail social. Retenant un moment particulier de cette séance, elle montre comment le temps de supervision qui a suivi a pu lui permettre d’élaborer cet épisode et de quelle manière a ainsi été amorcé, pour elle, un remaniement psychique. Elle peut dire maintenant que les espaces de supervision auxquels elle participe régulièrement représentent un lieu où l’élaboration lui permet de continuer à construire sa posture d’animatrice.
L’article de Laure Lafage et Narjès Guetat-Calabrese, intitulé D’un dispositif de « supervision » à visée formative ‒ À l’intention de futurs animateurs de groupes d’analyse clinique des pratiques professionnelles, présente un dispositif de supervision destiné à accompagner, dans le cadre d’un Master, le développement des aptitudes d’animateur des professionnels-étudiants en formation. La démarche des auteures repose sur l’hypothèse que c’est au sein des espaces de supervision que les animateurs débutants peuvent progresser dans l’adoption d’une posture qui facilitera le travail psychique des futurs participants de leurs groupes. Elles relatent leur expérience de co-animation de ce dispositif de « supervision clinique » et, à partir d’extraits des mémoires qu’elles ont accompagnés ainsi que de verbatims issus d’enregistrements de bilans de fin du cycle de supervision, elles montrent ce que les professionnels-étudiants perçoivent des effets du travail de supervision effectué.
La rubrique « Harmoniques » présente un texte de Kévin Toupin et Quentin Ramirez intitulé : Pré-commande, commande, demande ‒ Triptyque contemporain des pratiques psychosociologiques dans un contexte gestionnaire. En relatant leur expérience d’analyse des pratiques professionnelles (APP) dans un service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), les auteurs qui se présentent comme psychosociologues s’interrogent sur les mutations contemporaines des pratiques d’intervention psychosociologique que l’on peut repérer dans les institutions médico-sociales. Ils se demandant notamment comment déployer un dispositif d’analyse des pratiques dans un contexte organisationnel gestionnaire et quels mouvements psychiques ce dispositif produit sur le sujet, le groupe et l’institution ainsi que sur l’intervenant lui-même. Ils avancent que les logiques gestionnaires tendent à transformer les dispositifs d’APP en simples instruments de gestion et de contrôle, au détriment de leur vocation clinique et réflexive.
Hors dossier, les lecteurs et les lectrices trouveront un article varia de Konstantinos Markakis intitulé : Proposer un atelier d’écriture aux coordonnateurs d’Ulis collège ‒ Le partage du « muet » qui anime le texte. Dans ce texte, l’auteur présente le dispositif d’atelier d’écriture sur les pratiques professionnelles destiné aux coordonnateurs d’Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) en collège qu’il a co-construit et co-animé à la suite de la réalisation de sa thèse. Son but était de créer un espace pour travailler à la fois la complexité et la singularité des situations de ces coordinateurs et ainsi les accompagner vers une certaine reconnaissance de la place de leur propre subjectivité dans les situations professionnelles qu’ils évoquaient. À partir des comptes-rendus de préparation des séances, des notes prises in situ lors des séances de l’atelier et celles dans l’après-coup des séances de supervision, l’auteur met en lien son engagement de chercheur dans la conception et l’animation de ce dispositif clinique avec les effets produits sur le travail au sein du dispositif.
La rubrique « Reprises » présentée par Arnaud Dubois est consacrée à la traduction effectuée par Dominique Gelin d’un texte de Reinhard Fatke paru en 1985 dans Pädagogik und Psychoanalyse. Beiträge zur Geschichte, Theorie und Praxis einer interdisziplinären Kooperation. Dans ce texte, Reinhard Fatke défend l’idée selon laquelle la discipline fondamentale de l’éducation est la pédagogie. Pour lui, au même titre que d’autres sciences humaines, la psychanalyse peut certes éclairer, confirmer ou critiquer, mais elle ne doit ni fixer les finalités ni supplanter l’identité scientifique propre de la pédagogie. Il recentre ainsi la situation éducative comme impliquant la réciprocité (celui qui est censé devoir être éduqué influence de façon significative l’éducateur) et la contribution du sujet à sa propre éducation. Notons que Reinhard Fatke nous fait l’honneur ‒ qu’il en soit ici publiquement remercié ‒ de rédiger, pour cette traduction, une introduction inédite dans laquelle il apporte quelques éléments historiques permettant, en autres, de resituer le contexte dans lequel ses propos ont été initialement publiés.
Enfin, avant les résumés des articles, la présentation de l’HDR de Véronique Kannengiesser (Les subjectivités à l’épreuve du néolibéralisme dans les institutions éducatives et formatives : approche clinique d’orientation psychanalytique de l’autonomie et de la responsabilité) et de la thèse de Sandrine Bénasé-Rebeyrol (Le « faire équipe » dans les établissements innovants fédérés à la FÉSPI. Appareil psychique d’équipe et complexe de Thésée) soutenues récemment viennent clore ce numéro.
Bonne lecture,
Louis-Marie Bossard