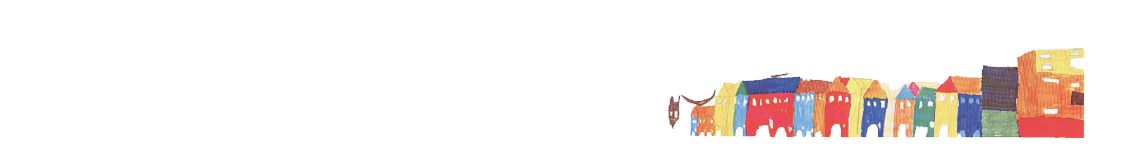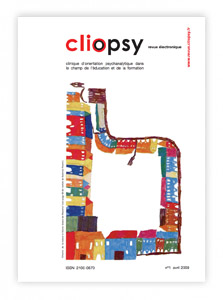N°33 – avril 2025
Éditorial
Ce numéro 33 de la revue Cliopsy est un numéro varia. Il est composé d’articles qui nous sont parvenus en dehors des réponses aux appels à contributions pour des dossiers, mais deux des cinq articles de recherche publiés cette fois-ci font écho au dossier du numéro précédent (octobre 2024).
Dans De quelques enjeux psychiques du co-enseignement, Marc Guignard propose une nouvelle analyse d’un corpus issu d’une recherche menée dans des classes uniques situées dans un milieu rural isolé ‒ département de l’Ardèche ‒ et ayant comme particularité la mise en place d’un dispositif de co-enseignement. À partir de l’analyse clinique de plusieurs entretiens couplés avec des observations d’enseignantes en poste dans ces classes, il dégage quelques pistes d’appréhension des mouvements psychiques potentiellement à l’œuvre pour les enseignant·es exerçant dans un tel dispositif et avance quelques hypothèses à propos des remaniements de leur rapport au savoir et de leur lien aux élèves. Il s’interroge également sur les conditions d’extension de la notion de transfert didactique à des situations d’enseignement à deux et invite à considérer la dimension intertransférentielle du lien entre les enseignant·es dans ces situations.
C’est à partir de l’analyse de trois entretiens cliniques de recherche menés à un an d’intervalle avec une même étudiante à différentes étapes de sa formation d’infirmière que Sandrine Jullien-Villemont formule des hypothèses pour répondre à la question qu’elle pose dans le titre de son article : Le rapport à la mort dans l’adolescence professionnelle des étudiants en soins infirmiers : une déclinaison du rapport au savoir ? Elle met ainsi en évidence, dans la progression de la formation, ce qui semble lié, d’une part, au besoin de continuité du sentiment d’exister et, d’autre part, à une forme de croissance psychique professionnelle repérable dans l’acquisition de la capacité à penser la mort des patients. Ce qui lui permet également de s’interroger sur la manière dont s’articulent l’adolescence et l’adolescence professionnelle des étudiants.
Après avoir présenté le contexte institutionnel de la justice pénale des mineurs, dans son article Regard clinique sur la pratique d’un éducateur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Laurent Ratazy s’interroge sur le conflit qu’un éducateur est amené à vivre dans sa pratique professionnelle entre sa réalité psychique et la réalité extérieure. En décrivant le cheminement de son questionnement de recherche puis en analysant le matériel recueilli à l’occasion d’un entretien clinique avec un éducateur, il avance l’hypothèse d’un recours à une stratégie inconsciente permettant aux éducateurs de se défendre contre les pressions induites par l’évolution de la justice des mineurs alors qu’ils sont pris en tenailles entre, d’un côté, le désir de rencontrer les jeunes qui leur sont confiés et, de l’autre, le besoin de se protéger des pressions institutionnelles.
Comme l’article précédent, celui de Siham Ez-Zajjari ‒ intitulé La temporalité psychique des adolescents à l’épreuve du Code de la Justice Pénale des Mineurs ‒ n’est pas sans rapport avec le dossier sur les « métiers du lien face au modèle gestionnaire » publié dans le numéro 32. À la suite de l’application récente d’une nouvelle procédure pénale qui promeut la rentabilité et la rapidité, l’auteure s’interroge sur les conséquences du redécoupage temporel de l’accompagnement éducatif des mineurs délinquants qui en résulte et sur son impact sur le nouage entre la temporalité psychique des adolescents et le temps judiciaire. Pour elle, c’est l’engagement des professionnels, leur capacité de survivance et leur créativité qui restent les ressources primordiales sur lesquelles reposent la qualité des accompagnements éducatifs et leur dimension clinique.
Enfin, c’est à la suite de la rencontre de référents décrochage scolaire dans une session de formation qu’il animait que François Le Clère s’est engagé dans une reprise théorico-clinique après-coup de sa thèse. Au milieu des multiples approches du décrochage scolaire, il choisit ‒ dans son texte intitulé Décrochage scolaire et travail du lien éducatif à l’adolescence ‒ de l’aborder à partir des théories de la mésinscription et de la notion de travail du lien propre à la traversée adolescente. Après avoir repéré comment la nomination « décrocheur » situe les adolescents du côté des désaffiliés et à quel point la relation éducative avec ces adolescents décrocheurs est paradoxale, il avance que cette situation peut éclairer le processus de subjectivation à l’adolescence et le travail du lien qui en constitue une modalité.
La rubrique « Dialogues » présente un article de Deborah Britzman ‒ intitulé Réflexions psychanalytiques autour d’une résistance discrète, ordinaire et douloureuse ‒ qui a fait réagir Rachel Colombe (la traductrice du texte) et Mej Hilbold. Initialement publié en anglais en 2010, ce texte porte sur la résistance ‒ au sens freudien ‒ dans le contexte de la relation pédagogique et semble de nature à dérouter les lecteurs et lectrices francophones, en particulier dans la manière dont il articule éducation et psychanalyse et dans la façon dont il fait le lien entre théorie et pratique. À la suite du texte traduit, Rachel et Mej tentent d’expliciter leur trouble à sa lecture et proposent de reprendre pour cela trois éléments de l’article.
À la suite de ces différents articles, les lecteurs et les lectrices trouveront une transcription de l’échange public mené par Marc Guignard avec Jean-Luc Rinaudo dans le cadre des rencontres périodiquement organisées par l’association Cliopsy. Après avoir indiqué comment était né, pour lui, le désir de travailler sur le rapport à l’informatique des enseignant·es, Jean-Luc Rinaudo a évoqué les grandes étapes de sa vie professionnelle et la manière dont elles lui ont permis de suivre l’évolution de la société, passant de l’informatique aux technologies de l’information et de la communication pour arriver au numérique, le tout au service de situations d’enseignement et d’apprentissage. C’est ainsi qu’il a pu constater que les phénomènes inconscients repérables dans toute situation d’enseignement sont rendus particulièrement visibles avec l’enseignement à distance et le numérique. Ce qui l’amène à s’intéresser, entre autres, aux conséquences de l’immédiateté du numérique sur le travail au long cours de tout éducateur, au rapport entre l’incertitude liée à toute situation d’enseignement et le fantasme d’être dans le « tout est sous contrôle » du numérique ou encore la problématique posée par la triade « voir, être vu et se voir » dans les situations des classes virtuelles.
Au cours de la confection de ce numéro 33, Eugène Enriquez est décédé. Bien que ne faisant pas partie de la « famille Cliopsy », ses travaux ont contribué largement à nourrir nos réflexions. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lui rendre hommage par une suite de contributions de celles et ceux qui, parmi les membres du comité de rédaction, ont rédigé quelques lignes en sa mémoire.
C’est aussi avec tristesse que nous avons appris récemment que Marta Souto nous avait quittés. Professeure en sciences de l’éducation à l’université de Buenos Aires (UBA), elle était membre du comité scientifique de la revue. Nous avons fait tout un chemin avec elle. En particulier, plusieurs enseignants-chercheurs du département de sciences de l’éducation de l’université de Nanterre ont été invités dans le cursus d’études lié à l’équipe clinique qu’elle avait construit à l’UBA. Par la suite, nous l’avons invitée comme « grand témoin » de nos premiers congrès, en 2006 avec José Luis Atienza, en 2009 avec Gerald Boutin et en 2013 avec Catherine Yelnik. Nous envisageons de republier l’un de ses textes dans un prochain numéro.
Ce numéro-ci se termine par trois recensions : celle de l’ouvrage de Gérard Neyrand, Critique de la pensée positive. Heureux à tout prix ?, rédigée par Jean-Claude Quentel ; celle du livre de Kathrin Trunkenpolz, Barbara Lehner et Bernadette Strobl, Affect ‒ sentiment – émotion : termes centraux de la pédagogie psychanalytique ?, proposée par Gerald Schlemminger ; et celle du livre d’Arnaud Dubois, Patrick Geffard et Gérald Schlemminger, Une pédagogie pour le XXIe siècle ‒ Pratiquer la pédagogie institutionnelle dans l’enseignement supérieur, que nous a fait parvenir Viviana Mancovsky.
Enfin, avant les résumés des articles, la présentation de trois thèses soutenues récemment vient clore ce numéro : celle de Catherine Pfister (Du passage à l’acte vers le recours à l’acte : fiabilité de l’objet externe et mobilité identificatoire chez l’adolescent carencé ‒ Étude multisite menée auprès d’adolescents placés en foyers de l’Aide Sociale à l’Enfance) ; celle de Laetitia Audin (La formation aux soins d’hygiène corporelle des étudiant·es en soins infirmiers à l’ère des technologies numériques : Le jeu vidéo Les Sims, un espace de professionnalisation ?) ; et celle de Noémie Salaün (Bavardage : quelle conceptualisation pour une éducation inclusive ? Prendre en compte la parole pour renouer avec le désir d’apprendre).
Bonne lecture,
Louis-Marie Bossard